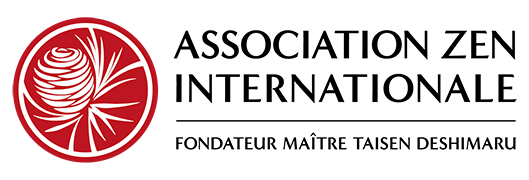Zen et vie quotidienne

L'esprit du zen au quotidien
La richesse de la spiritualité bouddhiste ne se limite pas à la pratique de la méditation assise. Bien que zazen en soit la source, l'esprit du zen s'incarne aussi dans différents aspects du quotidien.
L'art de la concentration
La concentration est cette faculté du mental de rester focalisé longuement sur une activité, sans être distrait. Dans notre société moderne, l'omniprésence des écrans (tablettes, smartphones...) encourage la distraction avec le passage rapide et surtout inconscient d'une activité à l'autre.
Dans le zen, la pratique de la concentration invite à rester attentif aux actes effectués, qu'on soit devant l'ordinateur ou en train de couper des légumes. Devenir pleinement présent aux choses du moment, apprendre à goûter l'instant, deviennent alors les trésors du quotidien.
Re-découvrir la simplicité
L'esthétique du zen se manifeste dans le dépouillement : une fleur dans un vase et un grand espace autour. Au-delà d'un aspect visuel épuré, il s'agit pour le pratiquant d'accéder à la joie des choses simples. Le goût d'une vie détachée des biens matériels, dans cette " sobriété heureuse " que décrit si bien Pierre Rhabbi. Une vie dans laquelle le respect de l’environnement occupe une place centrale. Une vie enfin, dans laquelle le pratiquant, en paix avec ses émotions, n'utilise pas la consommation pour combler un manque.
Le sens du rituel
Dans les monastères zen, dojos ou groupes de pratique, les rituels permettent de donner une autre dimension à la pratique de la méditation. Les cérémonies aident à s’harmoniser avec les autres et sont souvent dédiées " au bien de tous les êtres ". Au moment des repas (lors des retraites notamment) des chants bouddhistes invitent à développer l'esprit de gratitude pour tout ce qui a contribué au simple fait d'avoir à manger, et de penser à ceux qui n'ont pas cette chance. Ces intentions à elles seules montrent que la méditation va bien au-delà d'une pratique de développement personnel.
Un texte d'enseignement du maître Roland Yuno Rech
" On a souvent qualifié le zen de religion de la vie quotidienne.
Pour beaucoup de gens la vie quotidienne est perçue comme une succession d’activités contraignantes et ennuyeuses qui font penser que la vraie vie se situe ailleurs. La Voie spirituelle est parfois recherchée comme cet au-delà du quotidien. Or à partir de l’expérience du zazen, racine de notre vie, on réalise que c’est dans les actions les plus simples de la vie que l’ultime réalité s’actualise comme présence. La vie est alors vécue corps et esprit en unité. Elle nous rappelle l’importance de l’ici et maintenant.
L’éveil à l’impermanence nous invite à ne pas nous attacher à ce qui est périssable, mais qu’est-ce qui ne l’est pas ? Comment ne pas gâcher le temps précieux de cette vie humaine en ne passant pas à côté de l’essentiel ? L’éveil à notre unité avec les autres personnes nous invite à la bienveillance et à la compassion. Et l’éveil à l’unité avec toutes les existences invite à la communion avec la nature et nous pousse à l’aimer et à la protéger.
Cette expérience de l’éveil est le cœur de la Voie du zen et métamorphose le quotidien en lieu d’expression de ce que cet éveil implique : vivre chaque activité pleinement et pour elle-même en ne la réduisant plus à n’être qu’un moyen pour atteindre autre chose. Vivre ainsi nous réconcilie avec le manque, dédramatise les causes de souffrance et nous aide à retrouver l’harmonie avec la vraie nature de notre existence. "